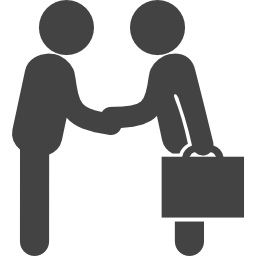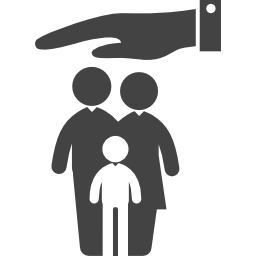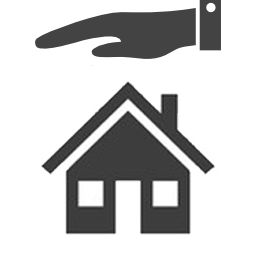Actualité Juridique
Sélection d'actualités
Le compte personnel de formation (CPF)
Depuis le 1er janvier 2015, le Compte Personnel de Formation (CPF) s'est substitué de plein droit au droit individuel à la formation (DIF).
A la différence du DIF, le CPF est attaché à la personne, de son entrée dans la vie active jusqu'à la retraite, c'est-à-dire qu'il suit l'individu tout au long de sa vie professionnelle en lui permettant d'acquérir des heures de formation financées, sans limite de temps, quels que soient les changements de statut professionnel. Tous les salariés en bénéficient, ainsi que les demandeurs d'emploi et les apprentis.
1) Fonctionnement du CPF
Le CPF est alimenté par les périodes de travail sachant qu'un salarié à temps complet cumule : 24 heures par année de travail dans la limite de 120 heures, Puis 12 heures par année de travail, dans la limite d'un plafond total de 150 heures. Pour un salarié travaillant à temps partiel, l'alimentation se fait au prorata du temps de travail effectué. Les heures inscrites dans le CPF ne sont jamais perdues, même si la situation du salarié change (changement d'employeur, par exemple). Les heures de DIF transférées dans le CPF (utilisables jusqu'au 30 décembre 2020) s'ajoutent à ce plafond total. Mais un salarié ne peut pas mobiliser plus de 150 heures au titre d'une formation donnée. Ce n'est pas l'employeur qui tient le compte du CPF des salariés puisqu'il est géré par la Caisse des Dépôts et Consignations. Depuis le 5 janvier 2015, chaque salarié peut activer son compte personnel de formation sur le site www.moncompteformation.gouv.fr. Il peut y consulter librement le nombre d'heures acquises ou encore les listes de formations possibles. Les heures du CPF des salariés sont créditées chaque année, par l'intermédiaire de la déclaration annuelle des données sociales (DADS).
Actualités juridiques - Archives
Actualités générales
Droit du travail
Informations Pratiques
Environnement
Droit de la Famille
Droit rural
Droit immobilier
Droit des nouvelles technologies
Droit de l'Entreprise
Droit de la consommation
Actualités récentes
Droit au logement opposable (DALO) : quand l’État est juridiquement tenu d’agir
Le droit au logement opposable, dit DALO, est un dispositif juridique permettant aux personnes en grande difficulté d’obtenir un logement ou un hébergement lorsque leurs démarches classiques sont restées sans réponse. Ce mécanisme transforme le droit au logement en une obligation légale pour l’État, sous certaines conditions.
Expulsion locative : comprendre vos droits et obligations avant qu’il ne soit trop tard !
L’article « Expulsion » sur Avocat.fr décrypte de façon pratique et juridique la procédure d’expulsion d’un logement en France, qu’il s’agisse d’une résiliation de bail pour loyers impayés, d’un refus de quitter les lieux en fin de bail, ou de comportements fautifs du locataire.
Vous envisagez de louer ou de prendre en location un logement meublé ?
La location meublée n’est pas simplement une location avec quelques meubles en plus : c’est un cadre juridique précis qui encadre les droits et obligations du bailleur et du locataire pour garantir un logement habitable immédiatement.
Locataire ou propriétaire : qui doit faire quoi ?
Dans ce guide clair et pratique, Avocat.fr décortique les réparations locatives : ces travaux d’entretien courant et petites réparations qui incombent normalement au locataire, selon la loi.
- Avocat Meaux Famille
- Avocat Meaux Travail
- Avocat Meaux Affaires
- Avocat Meaux Patrimoine
- Avocat Meaux Civil
- Avocat Paris Famille
- Avocat Paris Travail
- Avocat Paris Affaires
- Avocat Paris Patrimoine
- Avocat Paris Civil
- Avocat Chessy Famille
- Avocat Chessy Travail
- Avocat Chessy Affaires
- Avocat Chessy Patrimoine
- Avocat Chessy Civil
- Avocat Melun Famille
- Avocat Melun Travail
- Avocat Melun Affaires
- Avocat Melun Patrimoine
- Avocat Melun Civil
- Avocat Torcy Famille
- Avocat Torcy Travail
- Avocat Torcy Affaires
- Avocat Torcy Patrimoine
- Avocat Torcy Civil
Postulation
Tribunal de Meaux
Enchères
immobilières
Adjudications
Modal Dialog
This is a modal window. You can do the following things with it:
- Read: modal windows will probably tell you something important so don't forget to read what they say.
- Look: a modal window enjoys a certain kind of attention; just look at it and appreciate its presence.
- Close: click on the button below to close the modal.